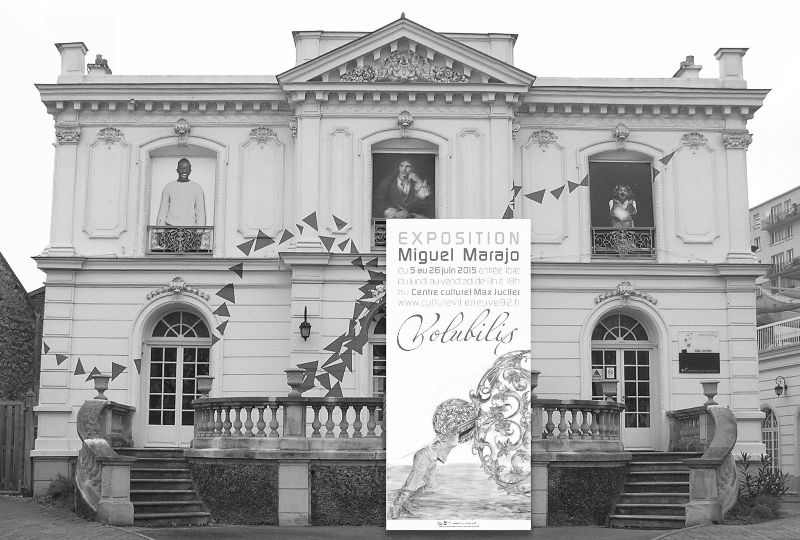Salut Francis !
Cela fait bien une douzaine d’années que nous nous connaissons Miguel Marajo et moi. Sa silhouette, souvent croisée dans les vernissages de l’ARC et ailleurs dans Paris, m’était familière avant que sa peinture ne le devienne. Sa peinture – son travail, comme on disait ici avant qu’il ne commence à peindre. Nous avions suivi, sans doute, des chemins parallèles, c’est pourquoi il nous fut facile de nous reconnaître. Parmi les œuvres qu’il a choisi de montrer cette fois, plusieurs pour moi sautent à l’esprit.
En disant cela, j’affirme surtout qu’elles bondissent – et qu’en jaillissant ainsi elles me paraissent s’imposer comme une évidence ; je parle des plus colorées et des non figuratives. De cet ensemble, dont je crois bien avoir vu les prémices dans son atelier, j’ai dû lui dire tout de suite qu’elles me faisaient penser à Picabia. C’est pour cela qu’elles me sautent aux yeux : non qu’il y ait une vraie parenté, mais je vois en elles, dans les couleurs comme dans les matières – dans le choix des tubes pour ainsi dire – et dans le fait d’opter pour des fonds terre de sienne passés à la colle quelque chose qui me rappelle les cartons de Picabia : des supports destinés au surgissement des bielles ou de ces spaghetti tirés du Ripolin. Des œuvres intrigantes, au titre lui-même picabien (Danse de la gâchette, Calimpsus…), qui ne me rappellent aucune peinture en particulier… aucune et toutes à la fois.
À quoi cela tient-il encore ? Sans doute au fait que j’y décèle – et ceci peut bien n’être que subjectif – une intensité et une propension au « lâchez tout » (et non au lâcher prise) qui est la marque de notre cher disparu.
« À bientôt Francis ! », lui écrivait Marcel Duchamp à l’annonce de sa mort. Or, du point où nous sommes aujourd’hui, tout porte à répéter ces mots chaque fois que l’occasion s’en présente ; en dépit du temps et de l’espace. Et c’est le cas avec Miguel Marajo… D’ailleurs, l’hommage dérivé auquel il nous invite croise comme par un fait exprès toute une génération dont F. P. fut sinon le centre, du moins l’un des essieux moteurs : celle de Dizzy Gillespie et celle de Picasso. Alors, inévitablement, le jazz, le noir de carbone – le fusain – évoquent un fonds à la fois évident et impossible à désigner. Une seule couleur – le noir.